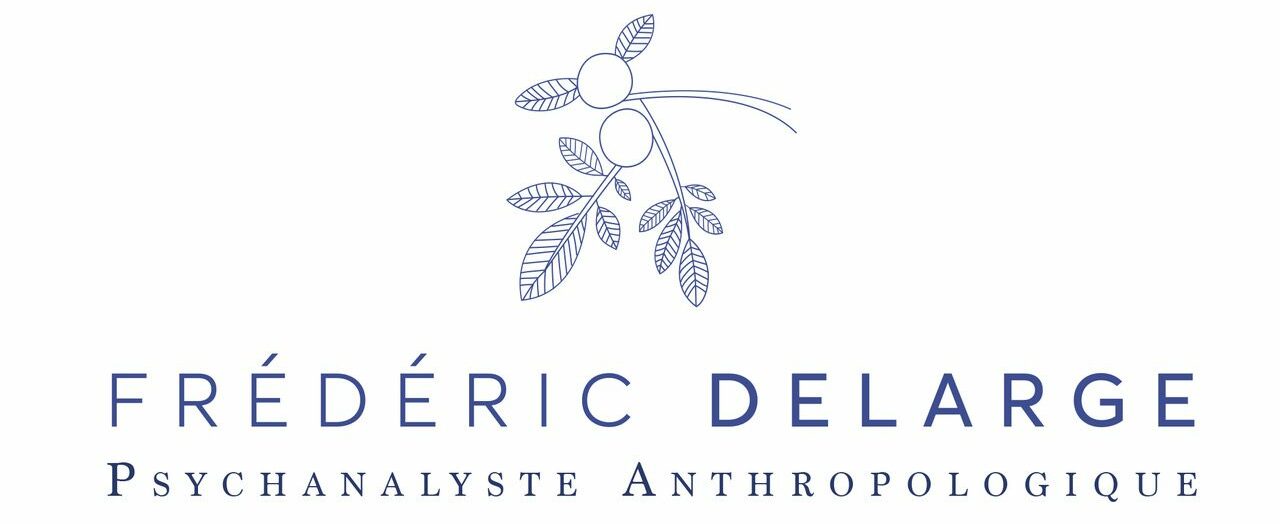CLAUDE MONET, Trois bateaux de pêches - 1885
Des livres, des films, des vidéos, des sites …
Nous sommes tous “au monde”. Nos parents dans un premier temps nous ont engendrés et nous ont aidés à grandir. Puis à l’adolescence chacun d’entre nous a du progressivement construire et penser sa vie en tenant compte de sa singularité, de l’éducation reçue et de la société dans laquelle il a été accueilli. Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Ainsi le premier enfant d’une nouvelle famille suscite de multiples interrogations, un changement professionnel peut être l’occasion de remises en cause très profondes etc. Les oeuvres de culture peuvent être un soutien, une ouverture, un premier éclairage. Nous pouvons dialoguer avec leurs auteurs.
C’est le but de cette page: vous offrir des pistes qui vous orientent dans ces grandes questions de l’existence qui nous accompagnent tout au long de notre vie “au monde”. L’actualité mais aussi mes propres recherches justifieront les choix proposés.
Le gamin au vélo, un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne,
avec Cécile de France et Thomas Doret.
Grand prix du festival de Cannes 2011.
Avec le Fils les frères Dardenne avaient déjà exploré les relations de filiation, celle d’un homme, menuisier de son état, qui prend comme apprenti un adolescent meurtrier de son propre fils. Le gamin à vélo inverse le regard cinématographique et se centre sur les difficultés à vivre d’un jeune de 10 ans rejeté par son père. Comment survivre quand votre géniteur vous abandonne sans mot dans un foyer, déménage sans adresse, vend votre vélo ?
Refusant l’évidence trop aveuglante, Cyril décide de récupérer le cycle, véritable lien filial, cordon qui le noue à la vie, au mouvement, à l’échappée belle vers l’avenir ? Récupérer le vélo et retrouver le père deviennent son obsession . Mais de ce lien le père ne veut pas et il finit par avouer son impossibilité matérielle, affective surtout, d’assumer ses devoirs éducatifs. Cyril, recueilli par Samantha, coiffeuse dans la cité, à la fois fort de son désir de vivre et faible de l’absence de l’homme-père, va être tenté de rentrer dans une petite délinquance de quartier, celle auquel l’invite un voyou de peu d’envergure mais pleinement conscient de l’absence de modèle paternel et des attentes de reconnaissance, d’encouragement et d’amour de Cyril. Celui-ci apprendra donc, par fidélité à Wes, à « attaquer la diligence » et emporter le magot. Mais au fond l’argent l’intéresse très peu, le lien que le butin peut contribuer à créer avec Wes, la fidélité qu’il peut permettre de renouer avec son père, lui importent beaucoup plus.
La délinquance n’est pas analysée ici comme choix moral : elle est la résultante d’une blessure et d’un manque. L’enfant a besoin que son géniteur, ou un homme de substitution, lui offre un cadre et une sécurité pour explorer le monde et lui permettre d’y inscrire son désir, sa sensibilité, sa créativité. Le sociologue américain Howard Becker parle de « carrière déviante » : le gang ou le grand banditisme ouvrent des perspectives de socialisation et de réussite tout autant que le barreau des avocats ou l’art culinaire des cuisiniers. La bande du quartier favorise un apprentissage social et peut contribuer à forger une identité que la distance du père rend ici illusoire. Le père est celui qui ouvre un avenir possible au fils.
La douleur muette de Cyril, son entêtement et sa bravade sont les symptômes d’une absence, d’un vide qu’il faut évacuer, absolument. La délinquance, en ce qu’elle noue des liens, est une porte de sortie. Samantha dans un premier temps n’y peut rien. Sa sollicitude et sa très bonne volonté, son attention maternelle, ne peuvent, face à la sauvagerie de pit-bull qu’exprime Cyril, se substituer au père. De fait Cyril n’a plus besoin d’une bonne mère attentive mais d’un père engagé, qui montre la voie de la réussite et d’une conquête du monde.
Tout d’abord désemparée, Samantha n’a pas de prise profonde sur le gamin. C’est pourtant dans sa détermination physique, batailleuse, frontale, à poursuivre l’expérience, à affronter les coups et les entailles, qu’elle permet à Cyril d’accéder à un début de repères, de retrouver les pédales de sa vie et de la lancer plus solidement sur la route. La scène où elle s’oppose, sans état d’âme, à la sortie de Cyril dans la cité parce qu’elle a compris qu’il était emporté vers l’accomplissement du délit, permet le basculement de leur relation dans un respect réciproque et une entente durable.
Un début de rédemption dont on perçoit bien qu’elle reste suspendue à d’autres possibles dérives et d’autres inévitables combats : à 10 ans rien n’est définitivement fixé. C’est cette force intérieure, plus masculine comme le fait remarquer Cécile de France dans un interview, qui va permettre progressivement à Samantha de faire entrer Cyril dans ce processus de castration qui consiste à renoncer à ses rêves impossibles et sa fixation sur un père idéalisé, mais angoissé et fragile, pour affronter la vie dans sa complexité et sa splendeur.
A l’est d’Eden, film d’Elia Kazan
avec James Dean, Julie Harris, Raymond Masse, 1954,
Oscar du meilleur acteur à Hollywood pour James Dean.
Voilà un film mythique qui a révélé James Dean, jeune acteur de 24 ans auquel Kazan a fait confiance pour un rôle d’adolescent en révolte contre un père enfermé dans une éducation à la religiosité rigide et surannée. James Dean ne fera que trois films, dont il ne verra la sortie que du premier. Il meurt prématurément dans un accident de la route qui contribue à en faire un véritable mythe du cinéma américain. Dès la sortie d’A l’est d’Eden les commentateurs comprennent qu’ils sont face à une nouvelle star. Et, de fait, si le film pourra apparaître vieilli dans sa facture, il faut le voir pour le jeu magistral de J.Dean.
Néanmoins la thématique reste totalement moderne quoique l’action se déroule dans la Californie des années de la 1ère guerre mondiale quand les E.U. décident de soutenir les alliés contre les allemands.
Cal(ed) est, avec son frère jumeau Aaron, le fils d’Adam Trask, paysan puritain et rigoriste, qui interprète les évènements et les comportements humains à travers sa lecture quotidienne de la bible. S’il y a le bien, incarné par Aaron, il y a de l’autre côté le mal qui s’exprime à travers Cal. Tous les trois vivent à Salinas Valley alors que leur mère est morte lorsqu’ils étaient en bas âge. Cal ne tarde pas à la retrouver cependant, femme d’affaire pleine de réussite, à la tête d’une maison close.
Cal fait tout pour conquérir l’estime et la reconnaissance de son père mais aucune de ses initiatives ne trouve son approbation. Finalement, par désespoir et vengeance, il entraine sont frère dans le bordel à la rencontre de sa mère et de l’« autre » réalité qu’elle symbolise. Aaron, désespéré, plein de rage, s’engage dans l’armée et le père fait une attaque cérébrale. Dans une ultime scène, au sommet du film, le fils sollicite un geste, un mot, du père mourant, lui qui reste à ses côtés.
Le film établit ce lien entre un adolescent imprévisible, renfermé, éventuellement violent, voleur si nécessaire, et l’absence de considération et d’encouragement du père. Il ne peut devenir homme que si, enfin, Adam le prend pour ce qu’il est et cesse de juger tous ses actes et propos : le cœur contre les principes, la vérité de l’être contre la morale biblique.
Tout enfant a besoin de se voir grandir dans le regard de ses parents, sentir qu’il est un être plein de promesse et pas uniquement selon une grille binaire du bien et du mal. Le père conserve une importance plus grande encore à l’adolescence en ce qu’il symbolise l’ouverture sur le monde que tout jeune de cet âge, avec ses peurs et ses doutes, souhaite conquérir, renouveler, améliorer. Le père est modèle pour les fils car il est lui-même un « conquérant », un aventurier qui s’est engagé au loin, loin du foyer, des habitudes, de la région, au delà des mers pour certains. C’est ainsi qu’il encourage ses enfants à risquer, à leur tour, leur existence d’adulte : « Toi aussi, comme moi, tu as quelque chose de ton être à engager dans le monde pour, à ton tour, réussir. »
La difficulté vient aussi des parents qui doivent accepter qu’eux mêmes basculent dans le passé, le révolu, le vieux, donc la mort. Seule cette acceptation laisse la place aux fils, au renouvellement du monde, à la vie en croissance. Le refus d’un temps qui passe et du déclin fait consciemment ou inconsciemment barrage au devenir des enfants.
Et Adam finalement, dans un murmure, lui signifie qu’il attend sa présence et son aide à ses côtés. Cal désormais reconnu va pouvoir s’ouvrir à l’existence. La mort prochaine du père annonce la naissance possible du fils.
L’enfant-cheval, La quête d’un père pour guérir son fils autiste,
Rupert Isaacson, 2009, J’ai lu
Si l’on aime le monde du cheval on sera ravi de croiser ces chevaux, Betsy, Blackie ou Blue, qui spontanément se soumettent devant, Rowan, l’enfant qui communique directement avec eux.
Si on souhaite mieux appréhender le monde de l’autisme on y trouvera des éléments forts de compréhension en vivant le quotidien de parents.
La puissance de ce témoignage tient à la rencontre étroite et si singulière du monde équin et du monde autiste. C’est dans cet entre deux que débute l’histoire, dans ces jours où Rowan, deux ans, s’enfonce dans sa fermeture autistique et que seule la jument Betsy parvient à rejoindre. Ce lien, simple, immédiat, va engendrer une épopée à dos de cheval et en cammionnette à travers la Mongolie. pour rejoindre le peuple du renne.
C’est un livre témoignage et à ce titre il vous bouscule intimement par la détresse de l’enfant et celle de ses parents. Nous sommes face à un couple dévasté, c’est si souvent le cas avec les situations d’autisme profond, par l’imprévisibilité, la répétition des hurlements, des cris, des coups que leur fils jettait plusieurs fois par jour sans raison apparente hormis une frayeur incontrôlable. C’est aussi l’incommunicabilité, retranché qu’il est dans sa bulle autistique, où le langage était plus proche du babillage, au mieux de l’écholalie, que d’un échange de besoins ou d’émotions. Le quotidien c’est également une incontinence absolue, permanente, qui engendre une présence totale et un nettoyage répété. Rowan est muré dans un isolement qui va croissant malgré les progrès le temps où, avec son père, il monte la jument. Partant de ce constat paradoxal et des échecs des méthodes de soin qui sont apportées, Ruppert rêve d’un voyage d’une solution inouïe : rejoindre le peuple Tsaatan et de Ghoste, chaman de ce peuple du renne.
Il fallait arracher le progrès au désespoir qui continuellement risquait de les submerger. Penser en termes de guérison ? Au moins revenir allégés des terribles colères et de l’impossible propreté, tenter de défier ce qui apparaissait comme un destin funeste et insupportable. Ils étaient devenus les gardiens d’une prison dont, en fait, ils n’avaient jamais eu les clés. Et ces clés passaient par un chaman perdu dans la taïga. Mais, on le sait, le chamanisme peut être très lié au cheval et la Mongolie est la patrie ancestrale de tous les chevaux actuels. Tout cela concourrait à organiser une folle aventure.
Le récit s’en tient constamment à la description phénoménologique de l’autisme et n’entre jamais dans les querelles théoriques qui marquent le monde (en France certainement) du diagnostic et du soin. C’est sa qualité car il nous fait ainsi participer aux espoirs et désespoirs de ce père, tout autant qu’à cet amour, presque impossible, qui se maintient, vaille que vaille, dans le couple et avec l’enfant, alors que la vie se resserre puis se limite à contenir Rowan. Finalement si les symptômes disparaissent largement et que des éléments d’explications sont apportés par le chaman, est-ce une guérison ? C’est Ruppert qui conclut : « Mais il n’a pas été complètement guéri. Et je ne voudrais pas qu’il le soit. […]Pourquoi ne pourrait-il pas nager entre deux mondes, garder un pied dans chaque, comme le font tant de neurotypique ?”
Aider les autistes c’est sans doute appréhender deux mondes et les aider à circuler entre eux, sans rester figés dans la peur extrême et l’enfermement que cette peur engendre.