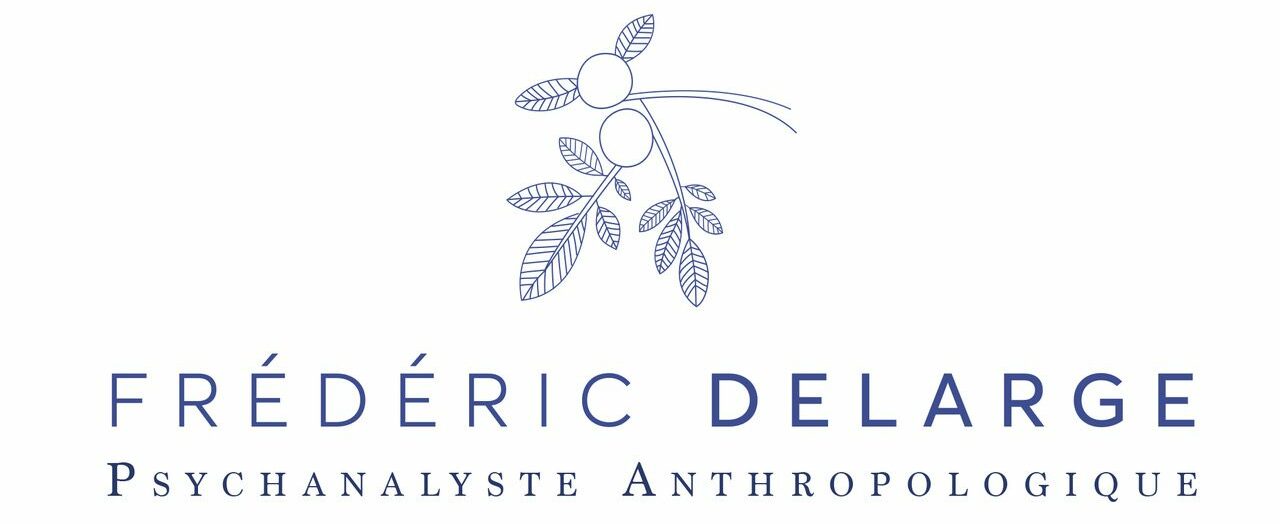L’actualité s’enrichit de passages à l’acte meurtriers, d’une jeunesse qui paraît avoir oublié les limites légales et sociales que la société s’était donnée. Le cas de cet adolescent de 14 ans qui poignarde une surveillante à l’entrée de son collège, sans avoir de grief personnel contre elle, parce qu’il a été grondé dans la cour quelques jours auparavant, paraît caractéristique d’une
évolution inquiétante.
Le psychiatre Serge Hefez dans un article du Monde (24 juin 2025) s’inquiète alors de l’omniprésence des écrans et de leurs effets sur la jeunesse. Il dénonce une absence d’empathie chez les jeunes qui passent en moyenne six heures par jour sur les écrans, particulièrement sur leur portable. Certains chercheurs mettent en avant l’augmentation de l’anxiété, de la dépression, la moins grande curiosité et les diffcultés relationnelles que l’omniprésence du téléphone engendre chez eux. Serge Hefez prône à la fois une restriction de l’usage des smartphones et une voie éducative pour aider à cultiver cette empathie qui aurait disparu.
Mais cette attitude ne fait qu’enregistrer l’existence des multiples écrans, des réseaux et de l’internet sans interroger en profondeur la reconstruction que ces outils font du monde. Comment un jeune pourrait-il aujourd’hui seulement imaginer un monde où le smartphone ne serait pas l’objet structurant de sa vie ? Ce qui était pourtant le cas il y a 15 ans ! La plupart de nos activités et de nos relations convergent vers l’écran posté dans notre poche. Il est facile de voir que cela transforme toute la vie sociale et personnelle. Observez bien les repas au restaurant, en famille ou entre amis. Le portable s’interpose, chacun le dépose à côté de son verre et s’autorise à le consulter quand il le souhaite, ou même remplace l’échange et le partage par sa consultation.
Désormais nous sommes hypnotisés par l’objet et les technostructures économico-politiques nous imposent non seulement l’outil mais les contenus, car c’est « du temps de cerveau disponible »1. L’insignifance et les formes nouvelles de marketing (par exemple les infuenceurs2) nous débordent de partout. Les spécialistes appellent cela le capitalisme de l’attention. Nos vies sont capturées par l’écran et vouloir s’en dégager est devenu absolument illusoire.
Dorénavant nous voyons le monde à travers les écrans. Dans un très fructueux débat sur C ce soir3, le sociologue David le Breton s’effraie de « la prosternation de tous les corps et les visages devant les écrans ». Immense paradoxe que celui qui nous tient à la fois isolé de nos semblables les plus immédiatement proches et en permanence rattaché par l’image et le scrolling à l’ensemble de la planète. Nous ne sommes plus ensemble face-à-face mais côte-à-côte. L’enjeu de ce débat est celui de la fn possible de la conversation, donc d’une certaine forme de sociabilité et de la démocratie.
Ce à quoi nous devons revenir est, me semble-t-il, en-deçà de la conversation : à la parole et au langage. Ce sont sûrement les philosophes qui peuvent éclairer les enjeux : « Venir au monde, c’est prendre la parole, transfigurer l’expérience en un univers de discours » (p.8).
La parole caractérise l’humain. C’est ce que les parents voient chez leur enfant en âge d’apprendre à parler: en nommant les choses, les êtres, les évènements et les situations, le jeune enfant sort de la pure expérience sensorielle et leurs donne une valeur qui est ordonnée par ses désirs ou ses intentions naissantes. Ainsi en désignant et nommant « le chat » il montre son intérêt pour lui et en faisant un pas son envie de le rejoindre. Le chat devient un être valorisé à ses yeux. Dans le même temps s’il dit « le chat » il s’adresse à ses parents qu’il regarde attentivement en attente d’une réponse ou d’une réaction. « Ah oui, tu l’as reconnu, c’est notre chat, il s’appelle …. » etc.
On saisit que l’enfant parle le monde et non pas « au monde » mais il le fait parce qu’il y a de l’autre (les parents). Pour avoir une parole il faut trois termes : moi, le monde et l’autre. La parole est donc paradoxalement à la fois moyen de s’affirmer comme sujet et moyen de communiquer avec d’autres. Elle s’inscrit ainsi dans un mouvement qui oscille en permanence entre expression de soi et communication avec l’autre. L’enjeu est de garder l’équilibre entre les deux dimensions.
Que se passe-t-il dans le face-à-face durable avec les écrans ?
Premièrement la valeur d’expression de soi de la prise de parole est réduite. Elle vise à plaire et glisse sur les attentes du public, sur les « likes » approbatifs. L’écran peut pourtant être l’objet d’un échange avec les gens qui nous entourent sur le monde qui s’y refête. Mais l’on sait combien il y a de pauvreté dans beaucoup de contenus et d’autre part combien les algorithmes sont construits pour nous renvoyer toujours sur des contenus identiques ou proches.
L’écran risque de nous conforter en nous renvoyant sur notre communauté, les idées que nous partageons et les intérêts que nous défendons, sans entrer en dialogue véritablement avec les autres. Voire en rejetant brutalement les univers sociaux ou mentaux qui ne nous sont pas communs.
Deuxièmement. La valeur communicative des écrans semble plus évidente puisque désormais nous pouvons à toute heure du jour et de la nuit nous connecter avec n’importe qui, n’importe où. Beaucoup d’outils internet ont cette fonction : on l’entend souvent « cela facilite la communication ». Sauf que peut-être cette communication est une simple circulation d’information et non l’engagement dans une parole singulière, originale, neuve. Cela peut-il l’être véritablement quand l’outil fonctionne sur l’instantanéïté et se contente plus d’un échange d’images que de mots ? Nous sommes plus souvent dans l’impulsivité d’une réponse que dans la recherche et la réfexion. Or une parole personnelle est forcément construite : c’est une pensée qui exige du temps pour s’affrmer.
La multiplication des écrans et des innombrables applications qui en constituent l’écosystème a pour première conséquence de réduire le rôle de la parole car elle écarte ce que la philosophie nomme autrui. S’il n’y a plus « d’autre » alors l’empathie que Serge Hefez voit disparaître en est un prolongement logique et inévitable.
1. Affirmait Patrick Le Lay quand il était à la tête de TF1
2. Voir l’article Tous influenceurs du Monde Diplomatique, juin 2025
3. Les écrans contre la parole, conversation entre Najat Vallaud-Belkacem, David le Breton et Julie Neveux, France télévision et Philosophie magazine, 20 mars 2024, p.31
4. Je m’appuye sur le livre La parole, de Georges Gusdorf, PUF, 1952.